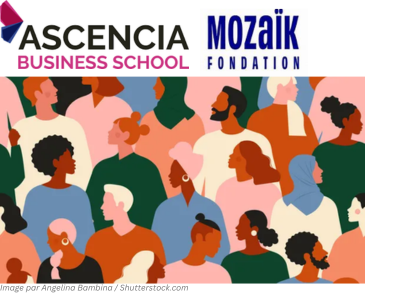Au tournant des années 2000, le rapport "Les oubliés de l'égalité des chances » publié par l'Institut Montaigne donnait naissance en France à la Charte de la Diversité. En l’espèce, les « oubliés de l'égalité des chances » faisaient principalement référence aux jeunes français, le plus souvent issus de l'immigration, vivant dans des banlieues défavorisées et en proie à un taux de chômage massif. Depuis, l’emploi du mot « diversité » est devenu un élément incontournable du discours des entreprises, des responsable politiques, des médias et des associations[1]. Aujourd’hui encore, le terme de « diversité » pallie fréquemment en France l’absence de vocable légitime dans le discours politique pour désigner les descendant·es d’immigré·es et les difficultés spécifiques qu’ils et elles rencontrent sur le marché du travail. Ce phénomène souligne l’extrême difficulté, gêne, pudeur, voire tabou lorsqu’il s’agit de faire référence dans le contexte français à la notion d’« origine ».
Si le terme d’« origine » peut renvoyer à de multiples critères, son usage courant opère un raccourci : l’origine est souvent réduite à une ascendance étrangère pouvant remonter à plusieurs générations[2]. Ce premier sens, que l’on peut qualifier d’« origine ethnique », renvoie au patronyme à consonnance étrangère mais également au phénotype des personnes, principalement la couleur de la peau, marqueurs sur lesquels s’appuient des jugements sociaux.
L’origine, entendue au sens large de l’ascendance, peut également être approchée au travers de la catégorie socio-professionnelle des parents. Elle fonde dans ce cas l’origine sociale d’un individu.
Proche de l’origine sociale, l’origine géographique désigne le territoire où la personne a grandi et/ou celui où elle réside actuellement. Deux critères géographiques font actuellement en la matière l’objet d’une attention particulière : les quartiers prioritaires des politiques de la ville (QPV), souvent situés dans les périphéries des grandes métropoles et les territoires ruraux, marqués par un éloignement des centres culturels et économiques.
Enfin, l’origine peut également être culturelle lorsqu’elle fait référence à une identité sociale fondée sur des pratiques ou sur une revendication[3]. Il faut cependant noter que l’appartenance culturelle et notamment religieuse peuvent faire l’objet d’assignation sur le fondement de stéréotypes associés à l’origine ethnique réelle ou supposée.
Distinguer les origines ethnique, sociale, géographique et culturelle permet ainsi d’éviter de réduire l’ethnique et le géographique au social. Ces éléments nous conduisent donc à parler des diversités des origines plutôt que de la diversité des origines.
Puisque les origines sont encore peu abordées en France lorsqu’il est question de diversité, cette journée d’études aura pour ambition de dresser un état des lieux de ce thème, à partir d’une déclinaison de ses différentes dimensions dans le champ des organisations. L’exploration du cadre français pourra être enrichi par des comparaisons avec d'autres pays, tels que les États-Unis et le Canada, où la question de la diversité des origines est plus institutionnalisée, offrant ainsi une perspective comparée sur les pratiques et les politiques d'inclusion.
Les nombreux enjeux explorés des diversités des origines permettront également d’esquisser des pistes de réflexion afin que cette question devienne un terrain plus fertile pour inspirer et inciter les organisations et les pouvoirs publics à agir. A ce titre, les propositions de communication devront notamment se concentrer sur des actions concrètes, des suggestions d’outils de mesure adaptés pour promouvoir la diversité des origines de manière plus effective.
Ainsi, les soumissions de communication pourront aborder les aspects suivants de cette thématique, sans que cette liste ne soit exhaustive :
- Comment dépasser le tabou qui entoure les diversités des origines en France ?
- Mesurer la diversité des origines : du fantasme de l’interdit aux expérimentations en tout genre
- Diversité des origines, au-delà de la question des discriminations ?
- Les diversités des origines, un nouveau champ pour l’intersectionnalité ?
- L’origine géographique, des problématiques communes aux tours et aux bourgs ?
- Diversité des origines et (in)action des Pouvoirs Publics.
- L’entrepreneuriat des personnes issues de minorités ethniques : un choix délibéré ou contraint ? avec quel(s) accompagnement(s) ?
Ces différentes thématiques ne sont pas limitatives et cet appel à communications se veut ouvert à toutes contributions, empiriques, théoriques et méthodologiques, appréhendant le management inclusif dans les organisations.
En complément des communications, cette journée sera également l’occasion de débat, table- ronde, ateliers au cours desquels experts, représentants du monde socio-économique et étudiants échangeront sur le sujet de la journée d’études (thèmes et intervenants à préciser).
 Chargement...
Chargement...